Pour Socrate, la chute c’est la conscience de notre exil, c’est le sentiment profond et viscéral qu’il existe « autre chose » que la banalité du monde quotidien nourri des savoirs et des savoir-faire du monde de la caverne. L’ascension est une force d’aspiration qui entraîne l’âme loin de son passé, un instinct de transcendance qui la conduit inéluctablement vers sa demeure véritable, vers le monde des étoiles. Mais au prix d’un arrachement douloureux car l’habitude de prendre pour réel ce qui n’est qu’une ombre est tenace. Icare a cependant, dans sa fougue, évacué l’étape de la réminiscence. Il chute non pas parce qu’il s’est élevé mais en raison de son impréparation : dans sa noyade il se laisse submerger par toutes les mémoires inconscientes, par les souvenirs envahissants qu’il n’a pas pris la peine de regarder intensément avec l’œil perçant de l’aigle. Comme aspiré par la lumière du soleil, il n’a jamais observé le fond de sa caverne intime. Cela est-il indispensable pour contacter le Soleil par la voie de l’intériorité ? Ni Socrate ni Icare ne l’affirment. Par contre l’homme héroïque de la caverne est passé d’arrachements en arrachements, il s’est décollé en quelque sorte de ce qu’il tenait pour la réalité, il a désidentifié sa conscience des ombres qui l’habitent afin de s’habituer progressivement à la lumière du Soi. Et il réalisera un jour que Celui-ci est le seul véritable guérisseur de ses mémoires de souffrances. En prime, ce contact direct avec la lumière touchera profondément la vie des siens. Tous ceux avec qui il a établit des relations proches et qui appartiennent à sa même famille d’âme verront leur vie bouleversée ou simplement changée. Les autres, et ils sont foison, riront de lui où, dans le meilleur des cas, ne comprendront pas son expérience du Réel.
Construire l’homme nouveau par la force ascensionnelle de leur idéal est donc le don qu’offrent les icariens à l’humanité. Ils montrent et osent sans cesse la possibilité d’un changement radical de « civilisation », que celle-ci soit intérieure, familiale, nationale ou planétaire. Ils sont au moins autant poussés hors du labyrinthe où ils perçoivent avec horreur ses conditions étouffantes, que tirés par la vision lumineuse d’un monde meilleur. Pour éviter la noyade – l’échec – ils devraient vérifier que leur conscience est bien décollée des valeurs du vieux monde et de toutes les « mémoires » qui en forment la trame. Le travail de réminiscence au sens socratique leur permettra cela. Dans le cas contraire, ils réaliseront un jour qu’ils sont coupés en deux, atteint d’une sorte de schizophrénie, entre la part de lumière qui devient de plus en plus utopique et la part d’ombre face à laquelle leur force d’élévation, un jour, cédera. Alors ce sera la noyade. Notons enfin que la sincérité concerne le processus d’élévation et non l’objectif à atteindre. Confondre l’un avec l’autre justifierait tous les fanatismes, tous ceux qui croient, comme Hitler hier ou les extrémistes religieux aujourd’hui, que la fin justifie les moyens. La sincérité sur laquelle nous avons longuement insisté est la capacité de reconnaître en permanence notre mensonge. Cette reconnaissance autorise la conscience à se transformer de seconde en seconde… jusqu’à ce qu’elle s’identifie enfin au Soleil-de-vérité, le grand inconnu qui se révèle tout en ayant toujours été là. Il ne s’agit en aucun cas d’une foi ou d’un objectif à atteindre que l’on imaginerait totalement vrai. Dans ce cas de figure l’effet serait exactement inversé : la conscience ne pourrait plus se transformer et poursuivre son processus d’élévation car elle resterait figée sur une « vérité » absolue, idéale et en réalité totalement illusoire.
La sincérité, de vraies ailes et la capacité de se décoller plutôt que de simplement s’envoler : telles sont les conditions de la réussite d’Icare.
Les icariens nous rappellent sans cesse qu’être un homme n’est pas donné par droit de naissance mais que c’est un état à conquérir. Et si c’était cela l’idéal d’un monde icarien civilisé : aider l’enfant à accomplir sa condition d’être humain, puis l’humain à devenir un homme vrai ? Curieusement, toutes les grandes civilisations sauf la nôtre ont produit un type humain spécifique : les Grecs ont créé l’orateur et le citoyen libre ; les romains, le guerrier ; le Moyen-age donna naissance à la chevalerie et l’Angleterre victorienne produisit la figure du Lord. Qu’avons-nous à proposer comme accomplissement d’un type humain « idéal » au jugement de l’Histoire ? Un consommateur pollueur ? A moins que ce ne soient les figures dédaliennes du technicien, du savant et de l’expert ? Peut-on considérer comme un idéal accompli un être qui s’est coupé du vivant ?
Dédale et les arts libéraux
« Les idées sont-elles aux anges ce que la matière est pour nous ? »
Kurt Gödel
Les pays en voie de développement envient notre modèle de société dédalienne[1]. Leurs habitants rêvent d’un monde d’abondance où la technologie libère de l’effort et produit du plaisir. Quant à nous, les citoyens de ce monde développé, nous n’en comprenons que trop les limites avec la perte du lien social ; l’ambiguïté de la notion de travail qui est à la fois un droit, une nécessité et un immense absorbeur de conscience et de liberté ; la conscience plus ou moins claire que notre économie conduit l’humanité à sa perte en raison de la surexploitation des ressources naturelles et des conséquences de la pollution. Tout se passe comme si notre modèle de civilisation n’avait plus de maître à bord. Il roule pour lui-même, sans se préoccuper des conséquences. La machine est par définition aveugle. Celle qui devait libérer l’homme de la servitude, dans l’esprit des Lumières, exerce à présent un pouvoir subtil sur notre manière de vivre ensemble. Par un étrange retournement de situation, l’esprit de la machine a absorbé la conscience de l’être humain dans ses filets. Pour voir cela clairement, il faut le recul d’un long séjour en Inde, en Amérique du Sud ou en Afrique, à moins que quelques semaines dans la solitude de la forêt ou du désert ne suffisent. Que voyons-nous au retour ? Un monde ultramécanisé et froid, un monde qui impose sa volonté de domination à une nature blessée de toutes parts par des routes, des tunnels, du béton, des pesticides… bref ! par une volonté de maîtrise sans faille. Un monde étrange où l’idéal proposé est un fonctionnalisme sans erreur : pas d’embouteillages, pas de ruptures de stocks, pas de conflits, pas de manques, pas de peurs, pas de bruits, pas d’échec…. La sécurité, l’abondance et l’absence de souffrance sont devenues ses mots d’ordre. Or tous ces termes qualifient le fonctionnement d’une machine idéale : alimentation, efficacité, production, sécurité, rendement, silence et insensibilité à l’environnement. L’homme « civilisé » perd peu à peu son humanité au profit de l’esprit de la machine qui s’insinue jusque dans son corps puisque celui-ci est aujourd’hui considéré comme une mécanique. Ses pathologies sont restaurées par des spécialistes qui changent ses organes, réparent ses dysfonctionnements par le bistouri et la chimie et, bientôt, modifieront son programme génétique. L’environnement est perçu comme une carrière à ciel ouvert où il suffit de puiser ; la réussite de la vie se mesure à la quantité de biens consommés et produits ; et enfin le degré de civilisation s’évalue au nombre d’objets fabriqués et à un chiffre : le Produit Intérieur Brut.
Lors de mon dernier retour d’Inde, je fus frappé par une évidence : nous sommes des barbares technologiques. L’homme occidental qui a inventé la machine pour se libérer des servitudes du travail est en train d’échouer en raison même du succès de son entreprise : les qualités imputables à une machine idéale sont devenues des idéaux humains incontournables : efficacité, rendement, sécurité, perfection, production….
Le combat ne se joue pas dans la vie politique, la science ou même l’éducation et la redistribution des richesses. Il se joue dans notre esprit. Il se joue dans notre œil. Il se joue dans notre conscience. Car, de notre manière de percevoir le monde, dépend notre action sur celui-ci et, par suite, le type de civilisation que nous construisons. Bien sûr, il faut un minimum d’adéquation entre la vision et le réel pour que cela fonctionne. Cependant tout décalage, si infime soit-il, entre le réel et notre représentation du réel finit par devenir un gouffre et ouvrir une béance. Dédaliens dans l’âme, nous imaginons alors qu’il faut lutter contre les dysfonctionnements sociaux, économiques et écologiques… alors que ceux-ci sont des bénédictions. Ils nous montrent à corps et à cris que le modèle d’un homme-machine et d’une civilisation uniquement technologique claudique quelque part. Il est parfois utile de compenser avec des semelles orthopédiques, mais le déséquilibre perdure au risque de laisser un lourd héritage aux générations futures.
Et si le degré développement d’une civilisation se mesurait à la capacité de ses habitants à vivre dans la joie sans cause ? Et si notre relation au monde n’était pas fondée sur la violence et le contrôle mais la confiance et l’accueil de l’incertitude ? Et si… ? Laissons aux icariens le soin de s’occuper de cela en distinguant l’utopie de l’illusion.
Le mythe ne condamne pas Dédale. Il s’en sort même fort honorablement puisqu’il s’échappe du labyrinthe et gagne son combat contre Minos. La scène finale du coquillage et de la fourmi laisse même entrevoir une porte sortie. En d’autres termes, la civilisation de l’homme-machine a son propre schéma mythologique de transformation. Icare n’est pas la seule solution radicale à l’enfermement de l’être humain dans le fonctionnalisme.
Il faut reconnaître que le brillant architecte qui résout tous les problèmes semble beaucoup plus raisonnable que son fils. Depuis longtemps, il considère l’instinct de transcendance comme une chimère dangereuse. Il affirme volontiers que les « familles d’âmes » sont de douces illusions réservées aux esprits faibles. Il a rangé les utopies dans le placard des archaïsmes primitifs de l’enfance de l’homme et prétend à présent vivre une vie adulte, débarrassée des illusions des « mondes meilleurs ». Certitude largement justifiée à ses yeux par l’histoire des idéologies qui créèrent si souvent des enfers aux noms de leurs bonnes intentions millénaristes. Pas plus que son fils, il ne croit en la religion. Foncièrement agnostique Dédale a une totale confiance dans son ingéniosité, un mélange d’intelligence et de sens pratique, pour affronter le réalité. Il n’est pas aussi radicalement individualiste qu’Icare puisqu’il a pris femme et conçu une descendance. Pourtant il vit dans le cercle étroit du labyrinthe, dans la double sécurité issue de son pouvoir de rationalisation - la pense du haut - et du sens de son appartenance à une famille sociale, nationale et culturelle : la panse du bas. Pour avoir péché contre Talos qui représente le Soleil, pour avoir oublié qu’il est un enfant divin, Dédale est aussi exilé. Mais, contrairement à Icare, il a compensé cette souffrance d’exil par plus d’ingéniosité encore, si bien qu’il en vint à oublier sa condition première et à se croire normal : dans le juste milieu, sain et sauf loin de tout déséquilibre, loin des envolées métaphysiques comme des plongées abyssales.
Bien sûr, il ne voit pas que chaque pas supplémentaire de son génie détruit un peu plus le vivant, en lui et en son extérieur. La fourmi sera l’ultime achèvement symbolique de cette œuvre mécanique. Jean de la Fontaine avait déjà compris que la petite bête n’était pas une joyeuse cigale chantant tout l’été ! Créature industrieuse, elle vise l’efficacité et le rendement. Même physiquement, son apparence cuirassée l’assimile à un robot, à un être mécanique où l’esprit de la machine a fait son nid. La travailleuse est incapable de décision, elle suit automatiquement la logique implacable de l’espèce où chaque membre est interchangeable. La fourmi est une sorte d’antithèse symbolique de l’abeille car cette dernière danse, s’élève vers le soleil au risque de la mort du faux bourdon, vit en communauté tout en conservant une part d’autonomie, honore enfin la beauté et la diversité biologique en pollinisant les fleurs.
Hélas ! Dédale, si sûr de lui et de la suprématie de son imagination créatrice, ne voit pas que le monde utilitaire sans risques ni fantaisies auquel il se voue corps et âme finira dans la grisaille des jours sans amour.
Alors il faut bien poser la question : l’intelligence est-elle un obstacle à la perception de la lumière des mondes métaphysiques ou existe-t-il un mode de pensée spécifique capable de « construire l’homme » pour son échappée belle hors du labyrinthe ? Sur ce point, les traditions divergent. Certaines affirment que la pensée tue le réel, que la figure de l’intellectuel pratique ne produisant que des représentations du monde est incapable d’une transformation ontologique. D’autres considèrent que la capacité de penser par soi-même est une étape intermédiaire, une sorte d’échelle de Jacob conduisant aux mondes suprasensibles. Dédale appartient à cette seconde catégorie. Il construisit le labyrinthe du savoir, s’en échappa, puis changea finalement de plan de conscience en perçant la dernière énigme.
La manière « dédalienne » de s’élever est remarquablement synthétisée par cette citation souvent reprise mais rarement recontextualisée[2] :
« Si nous voyons plus loin qu’eux, ce n’est pas parce que notre vue est plus perçante, mais parce qu’ils nous soulèvent et nous emmènent plus haut. Nous sommes des nains que des géants portent sur leurs épaules »
Nous devons cette métaphore à un auteur du XIIe siècle, Bernard de Chartres, l’un des enseignants majeurs de l’école néo-pythagoricienne située alors sur les pourtours de la cathédrale. Dans sa nef, sur le sol, est dessiné un labyrinthe. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’une allusion au Dédale Grec, car cette figure symbolique est universelle et remonte semble-t-il au rites liés à la Grande Mère issus de l’époque Néolithique, souvenirs perdus pour l’essentiel en raison de l’absence d’écriture[3]. Comme en une sorte de réminiscence, l’auteur de l’article sur le « Labyrinthe » dans l’Encyclopaedia Universalis cite tous les éléments labyrinthiques mis en scène dans le mythe d’Icare, la grotte-matrice, l’oreille, les intestins, le cerveau et le coquillage :
« Grotte dont les méandres se dissimulent au regard, souterrain dont les stalactites barrent les issues, entailles inquiétantes et adorées de l’épouse-mère, volutes intestines, sinuosités auriculaires, fines courbures de coquillages, les labyrinthes naturels se multiplient, sollicitant l’imagination humaine, qui ne cesse de les aménager, de les reproduire et de les réinventer: en architecture et en chorégraphie, dès l’époque minoenne; en mosaïque et en peinture comme sous l’Empire romain; dans l’art des jardins, dans celui de la chasse et du tournoi qui se développe au Moyen Age chrétien, dans la quête des anamorphoses et le goût du maniérisme; pour les épreuves d’initiation, pour les tests d’apprentissage; pour les jeux calligraphiques comme pour les recherches topologiques les plus avancées.
Tentons d’abord de définir d’un point de vue strictement formel l’écriture secrète que constitue le labyrinthe, dont le tracé, caractérisé par un degré plus ou moins grand de complexité, répond toujours à une intention d’initiation, sur un registre dont la sacralité ne semble jamais totalement absente. On pourrait définir le labyrinthe comme le contraire de la ligne droite: d’un point à un autre, le chemin labyrinthique n’est jamais le plus court; mais ceci n’implique pas qu’il soit le plus long, encore que ce puisse être le cas pour certaines formes très géométrisées.
De quoi le labyrinthe nous détourne-t-il à travers les corridors et les galeries qui dérobent aux regards du profane non seulement les dangers qui menacent l’aventurier mais l’enjeu même de sa pérégrination. Que recèle le labyrinthe? Est-ce le mort redoutable des hypogées égyptiens, le trésor interdit, le monstre ni homme ni bête? Est-ce, au contraire, le Graal, la pierre philosophale ou ces mystérieuses écritures rouges formées de souffles coagulés auxquels la tradition taoïste attribue la naissance de l’univers?
Mais, si nous revenons à la cellule originaire du mythe, le vrai labyrinthe n’est-il pas pour Thésée le principe féminin qui lui confère lumière, fil directeur et hache sacrificielle: cette Ariane, sœur du monstre, qu’il abandonne sur l’île de Chypre, une fois enceinte de ses œuvres? Quel est le pire des Minotaures? Est-ce la mère comme lieu de naissance et de mort ou bien la conscience dont les inextricables méandres dérobent au sujet le fruit même de son acte? Est-ce, en deçà du miroir, le leurre primordial et, au-delà, la forme véritable ? ».
Dédale s’échappe du « labyrinthe » en deux étapes. D’abord en déployant ses ailes artificielles, puis en « suivant » le chemin matérialisé par le fil attaché à la patte de la fourmi avide de miel. Il développe dans un premier temps un savoir qui l’élève, mais cela n’est pas encore suffisant. Il lui faudra apprendre à nourrir son âme engourdie par l’esprit de la machine du « miel » issu du monde magique. L’ingénieur ne peut s’enivrer sans limites comme Glaucos, directement et au risque de sa vie. Fidèle à ses convictions, le dédalien suit un chemin progressif loin des cimes comme des abîmes.
Alors, à quels savoirs Bernard de Chartres faisait-il référence ? Et qui sont ces géants ?
Les arts libéraux sont le fruit d’une synthèse entre la philosophie platonicienne et le christianisme. Ils furent structurés par Martianus Capella au début du quatrième siècle dans un récit allégorique en neuf volumes intitulé Les Noces de Mercure et de Philologie. Les deux premiers livres décrivent les fiançailles et le mariage de Mercure (Parole et Raison) et de Philologie (celle qui aime Raison) et l’apothéose de celle-ci. Mercure donne en cadeau de noces à Philologie sept servantes qui ne sont autres que les sept arts libéraux. Les livres III à IX contiennent les descriptions que chacune de ces servantes (ou sciences) fait de son art, constituant ainsi une véritable encyclopédie — la seule encyclopédie antique et païenne qu’aie connue le Moyen-Age chrétien latin, auquel elle fournira ses personnifications féminines des arts libéraux. Ce manuel, sans cesse commenté, servit de base d’enseignement dès les écoles carolingiennes.
Ici la connaissance est féminine. Elle sert à féconder l’élève et non à le rendre utile pour l’action comme cela est aujourd’hui le cas au sein de nos universités et de nos grandes écoles. Du reste les « sciences pratiques » comme l’artisanat, l’architecture et même la peinture n’en font pas partie.
La formation se divise en deux parties, le « trivium » et le « quadrivium ». Le trivium constitue la partie « littéraire » de la connaissance qui s'organisant autour de la grammaire, de la rhétorique et de la logique. Le quadrivium est la partie « scientifique » fondée sur le nombre : arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Bien que ne faisant pas partie des arts libéraux, la philosophie finit par être considérée comme le domaine de la connaissance qui englobait tous les autres.
Les arts libéraux, comme leur nom l’indique, ont pour objectif de rendre l’homme libre.
Il faut se souvenir que ni Descartes, ni Auguste Comte, ni Fueurbach n’étaient encore passés par là ! Il ne s’agissait pas de décrire la Nature et la société pour en comprendre les lois mais de sentir les résonances entre l’homme et l’univers au moyen de ces disciplines. Dans l’optique de l’enseignement profondément religieux du Moyen âge les arts libéraux préparaient à la théologie - à « comprendre Dieu » - et non à décrire les lois du monde matériel objectif comme s’y efforce aujourd’hui la démarche scientifique. Cette « co-naissance » fécondante avait pour objectif de rapprocher l’étudiant de Dieu ou, dans un langage plus contemporain, de le préparer à recevoir la présence du Soi.
[1]Notre modèle de civilisation initié au siècle prométhéen des Lumières fait aujourd’hui de larges concessions au mythe de Faust, celui qui gouverne par la peur et le secret tout en sachant que plus de connaissances lui donnera toujours plus de pouvoir et de contrôle. L’ingénieur Dédale n’étant pas un idéologue, il laisse tout cela de côté et met son génie pratique au service du mythe dominant. En d’autres termes, il peut indifféremment servir Faust en perfectionnant les centrales nucléaires, Icare en améliorant les capteurs solaires, Prométhée en inventant une nouvelle technologie ou Orphée en produisant des musiques qui guérissent les plantes malades. Dédale, comme la technique, sont des serviteurs qui obéissent aux injonctions d’un « roi », d’une conscience dominante adoptée par un dieu, une valeur fondatrice comme « Athéna » ou « Aphrodite ».
[2] Citée par René Querido dans L’Âge d’or de Chartres (Mortagne).
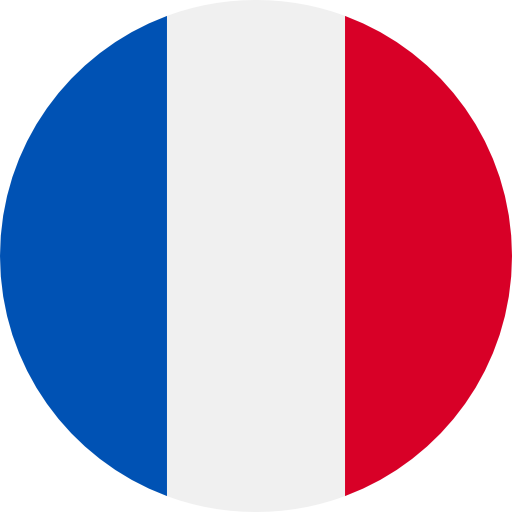 français
français
 english
english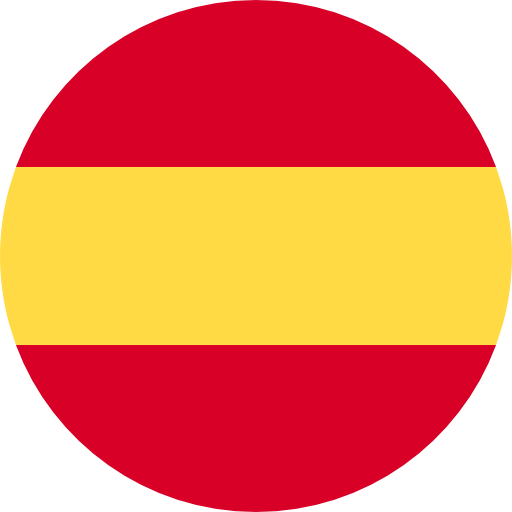 español
español русский
русский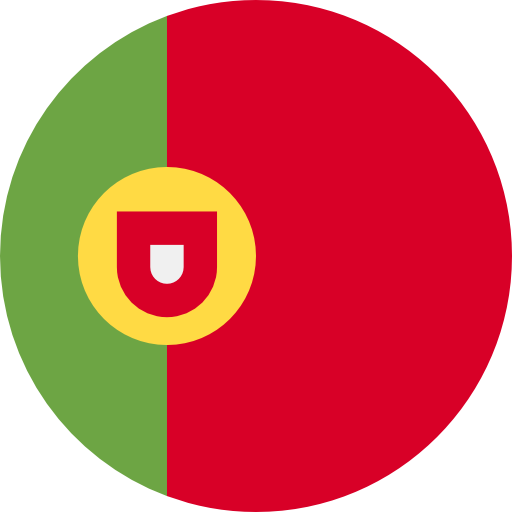 português
português
