Nous vivons dans un monde étrange. La rigueur de la pensée et de l’expérimentation scientifique, poursuivies sans relâche depuis trois siècles, mettent à notre disposition des pouvoirs et des conforts auxquels nul despote des temps passés n’aurait jamais osé rêver. Les machines se substituent aux esclaves pendant que les technologies de pointe réalisent l’impossible : communiquer instantanément d’un lieu à l’autre de la planète, parcourir physiquement le globe en quelques heures de vol, ou encore disposer sur les linéaires des supermarchés de productions en provenance de tous les horizons. Cette extraordinaire expansion à bien sûr un prix. Contrairement à ce qu’imaginaient les utopistes prométhéens du siècle des lumières, la boîte de Pandore s’est bien descellée pour notre malheur : le travail, jadis indigne d’un homme libre, est devenu un droit réclamé à corps et à cris ; la maladie resurgit en force, la folie souffla sur le monde lors de deux guerres mondiales, et ce mistral-là n’a guère perdu de sa puissance, encore aujourd’hui.
Comment dès lors comprendre la pauvreté en joie de l’homme moderne à qui les efforts de ses vaillants ancêtres ont légué la toute puissance, un confort jusque-là inimaginé et un savoir unique dans l’histoire du monde ?
Cette incroyable et héroïque tentative de l’homme occidental pour se libérer de la superstition, du mensonge, des approximations, des illusions religieuses et de l’obscurantisme des croyances se soldera-t-elle par un dérèglement climatique et des conflits sans fins où l’homme est devenu légalement « un loup pour l’homme » (ce qui est faire injure à l’animal des forêts) ? Curieusement, Prométhée, le Titan de la mythologie grecque qui apporta la connaissance aux hommes, avait déjà prévu ces inconvénients majeurs : le déluge, lycaon (« loup » en grec) et la boîte de Pandore appartiennent à la geste titanesque animatrice notre monde moderne depuis la révolution industrielle née en Angleterre dans les années 1760.
Notre drame et notre échec, c’est d’avoir jeté ensemble, comme sans y penser, le bébé et l’eau de son bain. Avec les flots usés de la superstition et des croyances, avec le rejet de l’argument d’autorité et le refus des explications magiques qui surnageait dans ces eaux-là, nous avons négligé le bébé, c’est-à-dire le cristal de sens qui les avait produites. En rejetant le religieux nous nous sommes libérés de la bêtise. Mais nous avons aussi laissé s’écouler dans les égouts de notre inconscient la présence du monde spirituel. Il en résulte un monde consumériste et matérialiste qui représente une victoire sur les obscurantismes du passé, mais qui incarne un monde déséquilibré au profit d’une seule lecture « hémisphère gauche » du réel. Cette conquête-là risque de se solder par une victoire à la Pyrrhus si rien n’est fait pour réintégrer le sens, les valeurs et la joie dans nos vies et dans notre culture. Ces derniers mots, vécus dans l’authenticité, se réfèrent tous à la dimension spirituelle. Ils ne peuvent être ni produit, ni achetés ni consommés. Et ils ne s’usent que si l’on ne s’en sert pas. En d’autres termes ils ignorent totalement les « lois » du marché et les règles de la Méthode cartésienne.
Tout se passe comme si nous avions exploré avec un succès remarquable la moitié de la réalité, celle qui s’objective et se mesure, en laissant pour morte son autre partie, celle qui nous parle de la qualité, de la vie, de l’enthousiasme, de la sérénité, de l’amour, de la paix intérieure (et par suite mondiale) et de l’équilibre des contraires. L’oubli était facile, bien qu’il fut dramatique dans ses conséquences. Facile, car le monde du sens était tellement pollué par les errances totalitaires des monothéismes qu’il était tentant de tout renvoyer au diable ; facile encore car la confusion entre le religieux et le spirituel fut longtemps entretenue – et existe encore, hélas ! dans de nombreux esprits.
Le retour du religieux mondial, auquel nous assistons aujourd’hui, résulte de ce manque de sens ressenti par l’exil du bébé dans les limbes de l’obscurantisme. C’est là un retour du balancier qui stigmatise le dangereux déséquilibre contemporain entre le savoir et la sagesse. Il s’agit, bien sur, d’une régression par rapport à l’extraordinaire et unique tentative historique de libérer l’homme de ses chaînes, en France par la Révolution (1789), en Angleterre avec l’émergence du libéralisme (1760) et aux Etats-Unis par le biais de la première démocratie constitutionnelle (1777).
En réalité il faudrait aujourd’hui compléter le « Discours de la Méthode » par un « Discours de la Mythode » qui explorerait, avec la même rigueur et la même exigence que la science contemporaine, le monde du sens. Comprendre par exemple que notre société s’articule autour de deux grands mythes, Prométhée et Faust, éclairerait sous un jour nouveau cette folie du monde que tous déplorent avec un désespérant sentiment d’impuissance.
De cette nouvelle « Mythode », le symbole est la pierre angulaire. Il « porte » en quelque sorte le sens, exactement comme les mathématiques « portent » notre compréhension du monde objectif. L’analogie s’arrête là. En effet, lors de cette exploration l’espace intérieur du chercheur se substitue au laboratoire de recherche ; le sens esthétique remplace le sens pratique, la subtilité se substitue à la force ; le non-effort et l’acceptation de l’inconnu priment sur l’effort et l’accomplissement d’objectifs assignés ; le lâcher prise marque la victoire alors que la conquête est l’indice de l’échec ; la coopération devient de plus en plus une évidence naturelle alors que les restes de l’esprit de compétitivité marquent l’inaccomplissement de l’unité du réel.
Ce monde du symbole et du sens incarne exactement l’opposé-complémentaire des « évidences » prônées par la pensée scientifique et usées, voire abusées, par la « logique » du libéralisme qui élève la réussite matérielle au rang d’un nouveau veau d’or.
Symbole et modernité
D’un langage non-verbal, parole de la nature et de l’inconscient, qui « dit » en permanence la nature de ces liens invisibles qui tissent des relations entre des « choses » aussi diverses qu’une planète, une plante, un être humain, une pathologie, un événement ou une symphonie. En d’autres termes, le symbole nous rappelle que nous vivons dans un univers où l’interdépendance est la règle et la hiérarchie l’exception. Il n’y a pas de « symbole étalon » comparable au mètre de référence qui fonde l’esprit scientifique. Il existe seulement une danse subtile des éléments où chacun résonne selon sa nature avec l’ensemble des autres chorégraphes de l’univers. Pourtant, les « dire » et les « expliquer » c’est déjà les trahir un peu. Lorsque l’expérience du sens devient vocabulaire son « je-ne-sais-quoi » de souffle traverse allègrement l’intimité de l’être qui le retenait encore pour se dissiper dans la grande lumière immuable de l’objectivité. Aller voir du côté du monde symbolique, c’est donc avancer à pas de loup dans la jungle intriquée des choses subtiles, frôler l’inexistence du moi jusqu’à ce que celui-ci devienne aussi transparent et sensible que possible pour, finalement, se laisser imprimer par les couleurs moirées et chatoyantes de l’inconnu qui s’annonce. Car le silence appelle le dévoilement du symbole. Il crée un vide où se love imperceptiblement le nouveau cristal de sens qui va reposer un instant sur l’ouate de notre conscience avant de susciter la force d’un renouveau encore impensé. Douceur et accueil sont les maîtres mots de l’univers du symboliste qui n’oublie jamais la nature féminine de Gaïa, notre Terre.
La chose n’est pas aisée dans notre modernité, ce monde qui déplace des montagnes non pour aller vers les jardins d’un quelconque Prophète, mais pour creuser des autoroutes vers le soleil d’un midi profane. Ce monde-là multiplie les occasions de bruit et de bavardages, il effraie des milliers colombes qui s’envolent à tire d’ailes, contrariant ainsi l’ardente intuition de Nietzsche qui affirmait que « ce sont des paroles silencieuses qui apportent la tempête ; des pensées qui viennent sur des pattes de colombes dirigent le monde ». Ce monde moderne confond la douceur avec la faiblesse, par sa barbarie même il réfute non le symbole – puisque celui-ci est inhérent au réel – mais toute opportunité de voir l’enchantement de la Terre que dévoile le regard symbolique.
Or la Terre est aussi un enchantement. Ce n’est pas seulement une carrière à ciel ouvert où tous les ambitieux et tous les assoiffés de reconnaissance jouent aveuglément comme dans une cruelle cour de récréation.
 Les arbres, les arbustes et les herbes, pour le symboliste, « disent » au moyen de leurs formes, de leurs couleurs et de leurs textures, les liens sympathiques qu’ils maintiennent avec les étoiles, mais aussi avec les organes du corps humain. Par ce qu’ils sont, ils décrivent très précisément leur sens : ce qu’ils soignent, et l’équilibre perturbé que leur simple présence réajuste. Poursuivant sur cette voie l’écologie se fait sensible. C’est une écologie à mille lieues de la compréhension intellectuelle du fonctionnement des écosystèmes. L’écologie sensible perçoit la beauté de la nature, dialogue avec les plantes et les rivières, un peu à la mode amérindienne, où encore dans l’esprit des travaux d’Edward Bach sur les élixirs floraux. Alors le jardin terrestre n’est plus seulement un monde assujetti aux caprices de homme mais un univers vibrant et vivant où l’être humain trouve sa place en devenant une fleur parmi d’autres fleurs. Pour la première fois, par la médiation du symbole, l’homme perçoitdirectement la nature de la Nature au lieu de projeter sur elle ses rêves et ses angoisses. Une société attentive à la présence vivante et vibrante du réel, à l’âme du monde, développerait une écologie naturelle où l’humanité ne serait plus considérée comme un enfant capricieux que doit allaiter la Terre-Mère - ou encore comme un apprenti maître du monde enivré par ses nouveaux pouvoirs - mais comme une conscience sensible co-participative à l’évolution des autres règnes de la nature selon leurs propres lois. Dès lors, avec cette conscience-là, comment sera-t-il possible de mettre en danger le biotope naturel de l’être humain ? Là où la loi et la force échouent, le simple changement de regard fait merveille.
Les arbres, les arbustes et les herbes, pour le symboliste, « disent » au moyen de leurs formes, de leurs couleurs et de leurs textures, les liens sympathiques qu’ils maintiennent avec les étoiles, mais aussi avec les organes du corps humain. Par ce qu’ils sont, ils décrivent très précisément leur sens : ce qu’ils soignent, et l’équilibre perturbé que leur simple présence réajuste. Poursuivant sur cette voie l’écologie se fait sensible. C’est une écologie à mille lieues de la compréhension intellectuelle du fonctionnement des écosystèmes. L’écologie sensible perçoit la beauté de la nature, dialogue avec les plantes et les rivières, un peu à la mode amérindienne, où encore dans l’esprit des travaux d’Edward Bach sur les élixirs floraux. Alors le jardin terrestre n’est plus seulement un monde assujetti aux caprices de homme mais un univers vibrant et vivant où l’être humain trouve sa place en devenant une fleur parmi d’autres fleurs. Pour la première fois, par la médiation du symbole, l’homme perçoitdirectement la nature de la Nature au lieu de projeter sur elle ses rêves et ses angoisses. Une société attentive à la présence vivante et vibrante du réel, à l’âme du monde, développerait une écologie naturelle où l’humanité ne serait plus considérée comme un enfant capricieux que doit allaiter la Terre-Mère - ou encore comme un apprenti maître du monde enivré par ses nouveaux pouvoirs - mais comme une conscience sensible co-participative à l’évolution des autres règnes de la nature selon leurs propres lois. Dès lors, avec cette conscience-là, comment sera-t-il possible de mettre en danger le biotope naturel de l’être humain ? Là où la loi et la force échouent, le simple changement de regard fait merveille.
De même, lorsque le corps parle de ses souffrances, lorsque la maladie dit le mal auto-infligé par celui qui ferme ses oreilles aux hurlements tragiques de son Destin, le bistouri supprime le symptôme… et entérine d’un coup vif la surdité ontologique du patient. Inversement, celui qui voit et entend que son corps symbolise un mal-être au moyen de la maladie évite la fuite dans l’absorption des pilules « miracles » des officines. Il verbalise le dit du mal, le « mal a dit » en vérité. Ainsi, lorsque le symptôme se fait parole, lorsqu’il devient conscience de quelque chose, celui-ci disparaît car il n’a littéralement plus « lieu d’être ». Une lecture symbolique du corps humain et de ses pathologies révolutionnerait les concepts médicaux aujourd’hui en usage… ainsi que le gouffre de la sécurité sociale !
Et puis il y a la vie quotidienne. Un jour, un journaliste demanda en substance à Einstein : « à votre avis, quelle est aujourd’hui la question la plus importante à résoudre ? » De la part d’un éminent scientifique la réponse attendue concernait un problème physique important pour l’époque. Mais pas du tout. Einstein répondit : « aujourd’hui, la question essentielle est de savoir si l’univers est accueillant ». Etonnant, non ? Et pourtant ! Ô combien est-il essentiel de vérifier si l’univers est bon ! Car s’il est « accueillant » plus rien ne justifierait la compétitivité, la concurrence, l’effort, la guerre, la société de contrôle et la hiérarchie autoritaire qui fondent notre réalité communautaire. S’il ne l’est pas, par contre, il est légitime de fonctionner sur la peur et de se barricader derrière des lois, des serrures de sécurité et une attitude de méfiance chronique. Or que nous apprend le regard symbolique au quotidien ? Que les événements de notre vie sont les reflets exacts de nos plus intimes pensées. Tout ce qui nous « arrive » n’appartient ni au hasard ni à la fatalité, mais est là pour éveiller notre conscience sur notre nature profonde. Les événements de notre vie sont autant de messages qui nous rappellent sans cesse qui nous sommes. Alors nous comprenons que l’univers n’est ni bon ni mauvais, il est simplement juste. C’est un fidèle reflet, à travers les événements qu’il nous propose de vivre, de nos peurs, de nos angoisses, de nos joies et de nos espoirs enfouis.
Les peuples racines surent conserver, à leur manière, cette relation au monde à travers leur cosmogonie, une cosmogonie vivante qui œuvre dans tous les domaines de la vie communautaire, depuis la nature jusqu’à la médecine en passant par la justice et la vie en groupe. Ce ne sont pas, pour nous, des modèles, mais des images. Des images qui nous rappellent que nous aussi nous vivons dans un monde « magique » que nous pouvons, si nous osons, redécouvrir.
La Terre enchantée par le symbole n’est pas un paradis new-age où tout le monde s’aime et se respecte dans l’utopie infantile d’un paradis de facilité, de facticité à vrai dire. Regarder droit dans les yeux les messages symboliques demande du courage. Le courage et l’humilité de sa fragilité ; le courage nécessaire pour l’ouverture de sa conscience vers des zones encore inconnues de soi-même et, finalement, le courage de l’amour de celui qui sait se laisser toucher par la nature du réel sans jamais le répudier ni chercher à le transformer.
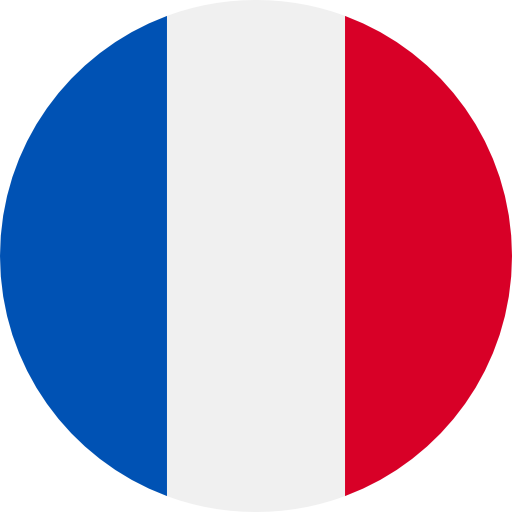 français
français
 english
english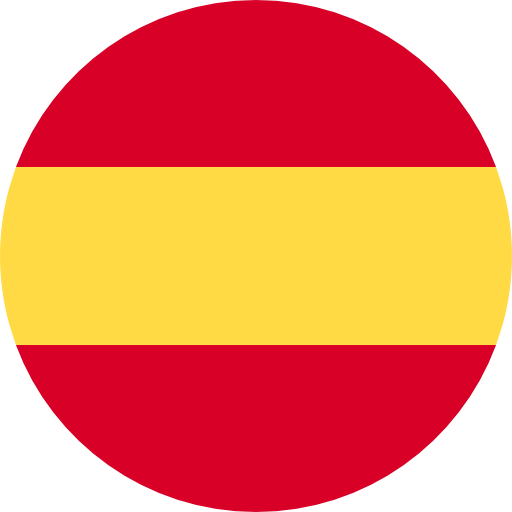 español
español русский
русский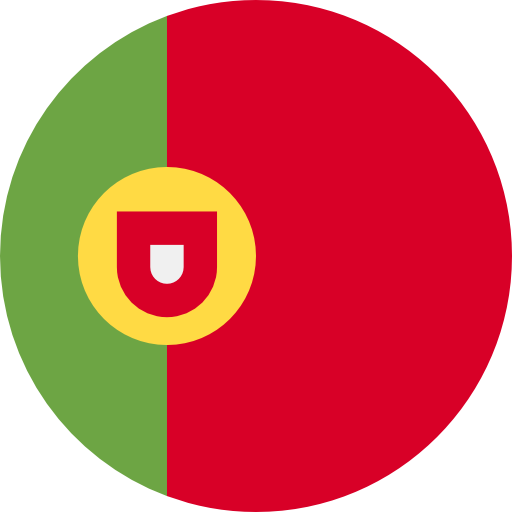 português
português


 Les arbres, les arbustes et les herbes, pour le symboliste, « disent » au moyen de leurs formes, de leurs couleurs et de leurs textures, les liens sympathiques qu’ils maintiennent avec les étoiles, mais aussi avec les organes du corps humain. Par ce qu’ils sont, ils décrivent très précisément leur sens : ce qu’ils soignent, et l’équilibre perturbé que leur simple présence réajuste. Poursuivant sur cette voie l’écologie se fait sensible. C’est une écologie à mille lieues de la compréhension intellectuelle du fonctionnement des écosystèmes. L’écologie sensible perçoit la beauté de la nature, dialogue avec les plantes et les rivières, un peu à la mode amérindienne, où encore dans l’esprit des travaux d’Edward Bach sur les élixirs floraux. Alors le jardin terrestre n’est plus seulement un monde assujetti aux caprices de homme mais un univers vibrant et vivant où l’être humain trouve sa place en devenant une fleur parmi d’autres fleurs. Pour la première fois, par la médiation du symbole, l’homme perçoitdirectement la nature de la Nature au lieu de projeter sur elle ses rêves et ses angoisses. Une société attentive à la présence vivante et vibrante du réel, à l’âme du monde, développerait une écologie naturelle où l’humanité ne serait plus considérée comme un enfant capricieux que doit allaiter la Terre-Mère - ou encore comme un apprenti maître du monde enivré par ses nouveaux pouvoirs - mais comme une conscience sensible co-participative à l’évolution des autres règnes de la nature selon leurs propres lois. Dès lors, avec cette conscience-là, comment sera-t-il possible de mettre en danger le biotope naturel de l’être humain ? Là où la loi et la force échouent, le simple changement de regard fait merveille.
Les arbres, les arbustes et les herbes, pour le symboliste, « disent » au moyen de leurs formes, de leurs couleurs et de leurs textures, les liens sympathiques qu’ils maintiennent avec les étoiles, mais aussi avec les organes du corps humain. Par ce qu’ils sont, ils décrivent très précisément leur sens : ce qu’ils soignent, et l’équilibre perturbé que leur simple présence réajuste. Poursuivant sur cette voie l’écologie se fait sensible. C’est une écologie à mille lieues de la compréhension intellectuelle du fonctionnement des écosystèmes. L’écologie sensible perçoit la beauté de la nature, dialogue avec les plantes et les rivières, un peu à la mode amérindienne, où encore dans l’esprit des travaux d’Edward Bach sur les élixirs floraux. Alors le jardin terrestre n’est plus seulement un monde assujetti aux caprices de homme mais un univers vibrant et vivant où l’être humain trouve sa place en devenant une fleur parmi d’autres fleurs. Pour la première fois, par la médiation du symbole, l’homme perçoitdirectement la nature de la Nature au lieu de projeter sur elle ses rêves et ses angoisses. Une société attentive à la présence vivante et vibrante du réel, à l’âme du monde, développerait une écologie naturelle où l’humanité ne serait plus considérée comme un enfant capricieux que doit allaiter la Terre-Mère - ou encore comme un apprenti maître du monde enivré par ses nouveaux pouvoirs - mais comme une conscience sensible co-participative à l’évolution des autres règnes de la nature selon leurs propres lois. Dès lors, avec cette conscience-là, comment sera-t-il possible de mettre en danger le biotope naturel de l’être humain ? Là où la loi et la force échouent, le simple changement de regard fait merveille.