 |
De « la Méthode » vers « la Mythode » ?Symbole et sens L’occident à, depuis trois ou quatre siècles, fondé sa représentation du monde un immense paris : celui de la rationalité du réel. Des philosophes à la pensée profonde comme Leibnitz, Kant puis Hegel sont à la source de notre manière de comprendre la réalité. En affirmant la rationalité du réel ils ont ouvert les grandes avenues de la science et de la technologie, pavant notre vie quotidienne d’une capacité de contrôle sur la nature et sur nos vies à nulle autre pareille dans l’histoire de l’humanité. La superstition et les pseudo explications globalisantes vécurent la fin de leurs beaux jours sous la houlette de l’expérimentation rigoureuse et de la vérification. Hegel fut sans doute le dernier penseur global de la Nature, s’intéressant à la fois à l’art, à l’histoire et aux sciences de son époque. Cette victoire de la pensée, que les scientistes[1] considèrent comme ultime, est aujourd’hui comme débordée par un certain nombre de faits, tant scientifiques que « magiques », face auxquels nous ne pouvons qu’opposer trois nouvelles hypothèses. Soit ceux-ci ont une explication rationnelle encore incomprise du fait de l’imperfection des théories actuelles ; soit il existe une autre forme de rationalité qui inclut et dépasse celle que nous connaissons ; soit, enfin, la connaissance du réel fondée sur la pensée est impossible dans sa totalité car limitée par la nature biologique du cerveau humain, qui est, ne l’oublions pas, le fruit d’une évolution naturelle inachevée. Le mythe du ProgrèsEliminons d’emblée la thèse du Progrès qui est la simple continuation des idées philosophiques développées depuis trois siècles. Cette posture de la pensée est largement partagée, trop du reste puisqu’elle est devenue – on se demande pourquoi – une vérité quasi-universelle au risque de se transformer en mythe, au sens de sa définition anthropologique : le discours fondateur invérifé qu’une société tient sur elle-même. En effet, le matérialisme et la raison ne sont plus aujourd’hui l’objet d’une réflexion philosophique mais sont devenus une simple une « évidence » acceptée par beaucoup. Le catholicisme puis Hegel ont affirmé que Dieu est Raison, puis la raison est devenue l’outil d’exploration du monde. Or, que ce soit délibéré, conjoncturel ou une conséquence nécessaire de ces idées, force est de constater qu’il n’existe plus aujourd’hui de philosophes capable de nous aider à réfléchir sur les grandes questions fondamentales et de renouer avec ce qui particularise l’être humain : qu’est ce que ma mort ? comment celle-ci m’aide-t-elle à penser ma vie ? qu’elle est la nature du sens ? qu’est-ce que la réalité ? qu’est-ce que c’est que d’être un homme ? quel est mon rapport aux autres règnes de la nature ? comment me relier à l’univers ? Au lieu de cela la raison toute puissante, jointe à la dissolution de l’enseignement philosophique et artistique, à façonné une société de bons ingénieurs et de techniciens remarquables qui vouent leur vie au service du mythe du Progrès et de ses conséquences : le consumérisme, la sécurité d’un appartement et d’un travail, le commerce comme valeur première et un « épicurisme » qui ferait rougir le vieil Epicure. En d’autres termes les réussites de notre société occidentale ne sont pas la preuve de l’omnipotence de la Raison. C’est exactement l’inverse : l’hégémonie de la rationalité positiviste à produit notre modernité. Une modernité qui adhère aveuglément à son histoire et, du coup, s’interdit, toute remise en question. De simples anicroches dans le tissus serré de la raison soulèvent d’immenses et impensables boucliers de la part des zélateurs du progrès, exactement comme s’il s’agissait-là d’un sacrilège. Témoins les incroyables péripéties et avanies que dû subir Jacques Benvéniste lorsqu’il montra scientifiquement que de l’eau dynamisée pouvait guérir. Philosophiquement cela remettait en cause le principe fondateur de la chimie moderne, à savoir que seule de la matière et des forces peuvent agir sur une autre matière. En effet, au-delà de 9CH les dilutions homéopathiques ne contiennent plus aucune molécule chimiques issues de la solution mère. Témoins aussi les (faux) débats médiatiques sur l’astrologie, la voyance ou les tarots qui, fautes de pouvoir prouver leur rationalité, sont attaquées comme des ennemis dangereux du fondements de notre société : la raison. Pourtant ne considérer comme réel que ce que l’on peut démontrer est absurde : je ne connais pas pourquoi mon cœur fonctionne (et personne ne le sait) et pourtant il fonctionne ! Heureusement la communauté humaine aura toujours ses Galilée, ceux qui reconnaissent les évidences au risque de troubler les certitudes aveugles de leurs contemporains. Le mythe du Progrès, outre le fait de clore le débat philosophique sur des questions pourtant essentielles, nous a rendu otages de l’esprit de la machine. L’homme occidental qui a inventé la technique pour se libérer des servitudes du travail échoue aujourd’hui à cause du succès de son entreprise. En effet les qualités imputables à une machine idéale sont devenus des « idéaux » humains incontournables : toujours plus d’efficacité, de rendement, de sécurité, d’abondance et de production. C’est cette aliénation de l’esprit humain à l’esprit de la machine qui constitue sans doute le plus grand drame contemporain. L’inachèvement de l’hommeNous laisserons également de côté la troisième hypothèse. Celle qui reconnaît l’immaturité du cerveau humain et sa totale dépendance envers l’évolution biologique et la culture prodiguée par la société. Car la question est difficile. Comment en effet explorer la nature de la réalité avec un outil encore dans l’enfance ? Comment prétendre développer une philosophie du réel qui tienne la route si le véhicule est relatif ? Avant de penser il faudrait, en quelque sorte, adapter son corps, son cœur et son esprit à la nature de la réalité, c’est-à-dire à l’Inconnu. Ce monde-là est exploré par les mystiques qui acceptent de mourir à leurs représentations pour se laisser enseigner, et « ensaigner », par le Mystère. Ici connaître c’est désapprendre. Bien que cette voie soit la seule qui soit vraiment raisonnable il est difficile de la penser avec un cerveau contemporain. Le Progrès est habituellement défini comme la capacité des cultures à fabriquer des objets, et nous somme devenus des champions hors normes dans ce domaine. Pourtant un « mystique » définirait le progrès différemment : comme la capacité croissante d’un peuple à vivre et à partager la joie sans cause. Après avoir rappelé rapidement les succès et les conséquences dangereuses d’une vision du monde fondée uniquement sur la raison et sur l’idéal du Progrès, après avoir évoqué la nécessaire humilité qu’impose toute recherche de la vérité à cause de nos limitations biologiques et de nos conditionnement culturels, il nous reste à explorer plus en détails la troisième hypothèse. Existe-t-il une autre forme de rationalité qui aurait échappé à la sagacité du siècle des Lumières ? Le monde symboliqueIl faudrait aujourd’hui compléter le « Discours de la Méthode » par un « Discours de la Mythode » qui explorerait, avec la même rigueur et la même exigence que la science contemporaine, le monde du sens[2]. Comprendre par exemple que notre société s’articule autour de deux grands mythes, Prométhée et Faust, éclairerait sous un jour nouveau cette folie du monde que tous déplorent avec un curieux sentiment d’impuissance. Mais avant d’entrer dans l’univers des symboles il convient de clarifier la posture philosophiques qui sous-tend notre démarche. L’a priori métaphysique des Lumières était d’imaginer que notre réalité pouvait s’expliquer à partir de phénomènes physiques régis par la causalité. Dieu fut relégué au rang d’un Etre Suprême ayant ses propres lois inconnaissables, puis l’échec de la dimension métaphysique du programme de Descartes le fit disparaître des questions raisonnables. Il appartient désormais à la sphère privée et n’est plus un objet de connaissance. Un autre a prioriest cependant envisageable, vieux comme le monde. Celui qui envisage que l’univers du sens (ou « dieu ») interagisse en permanence avec les mondes objectif et subjectifs au moyen d’une « transcausalité » libre de toute rationalité physique. Dans ce cas le divin redeviendrait un « objet » de connaissance, mais à certaines conditions :
Examinons ces points en détail avant d’observer à quoi pourrait ressembler un tel monde qui prendrait en compte une préexistence du sens. Le sens ne se construit pas, il se révèleLes panneaux de la circulation routière forment un système de signes élaborés par la raison pour coder un comportement, c’est-à-dire du sens. Leur efficacité résulte de l’action conjuguée de la culture et de la loi, de l’apprentissage et de la répression. D’évidence, ils n’ont rien de symbolique. Pourtant, à y regarder de plus près, le symbole n’a pu s’empêcher de s’y immiscer. Prenons à titre d’exemple la couleur rouge que l’on retrouve sur les sens interdits, les feux tricolores et les panneaux « stop ». Curieusement une même couleur marque toujours le danger et l’interdiction. La Chine de Mao Ze Dong à l’aube de la Révolution Culturelle avait bien tenté de remplacer la fonction du feu rouge par une lumière verte, mais la pagaille fut telle qu’il fallut rapidement revenir en arrière. Au grand dam de ce régime « rouge » qui trouvait fort inconvenant d’associer sa couleur fétiche à des valeurs d’arrêt et de danger ! Les Mandarins de la Chine Impériale comme les instituteurs de la République utilisaient des encres rouges pour corriger les fautes de leurs élèves et signaler le danger d’une erreur grammaticale ou orthographique. Tout se passe comme si le sens du « rouge » s’était imposé aux hommes par-delà les idées qu’il pouvait porter sur lui, par delà les cultures et les périodes historiques. Depuis les travaux de Georges Dumézil sur la tripartition fonctionnelle nous savons que trois grandes fonctions organisent à la fois la mythologie, la vie sociale et l’expérience quotidienne des peuples Indo-européens[3]. Il s’agit de la fonction de souveraineté qui détient le pouvoir juridique du contrat et le pouvoir magique des charmes, de la fonction guerrière qui a pour tache de canaliser l’énergie afin de la transformer en valeurs de conscience, et de la fonction de production occupée à la multiplication du même. Blanc et or appartiennent à la Souveraineté, le rouge est relatif au Guerrier, le bleu et le vert sont du domaine de la Production. « Canaliser les flux d’énergie pour créer plus de conscience », n’est-ce pas là le rôle des feux rouges et des instituteurs ? Et puis est-ce un hasard si les deux nations qui mirent en mouvement l’immense processus de destruction de la seconde guerre mondiale affirment leur identité en arborant fièrement un drapeau où domine le rouge ? Est-ce un hasard si les pays « rouges » - l’ex-URSS et la Chine communiste - firent ensuite régner la terreur en multipliant les massacres sur leur propre territoire ? Inversement l’Europe n’arrive que très difficilement à s’accorder sur une armée commune alors qu’elle se signe avec drapeau bleu et or. Deux couleurs qui marquent la production unifiée (fond bleu) et la souveraineté partagée (étoiles jaunes). Il lui manque la couleur rouge de la « guerre ». Les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France possèdent tous un drapeau tricolore. Ces trois nations furent à un moment où à un autre de leur histoire capables d’harmoniser les fonctions de souveraineté, de guerre et de production pour construire un Empire. Evidemment, le symbole national ne « démontre » rien ni n’est la cause de l’histoire des nations ! Le penser serait revenir à une logique causale de pacotille qui confinerait à la superstition. Ce serait feindre de croire que la force électromagnétique de la lumière rouge arrête l’automobiliste à la croisée des chemin. Le symbole « rouge » montre simplement - et c’est déjà beaucoup – la nature de l’Etre qui s’en habille. Il ne dit ni ce qu’il fera, ni comment il agira. Le symbolisme n’explique rien, il ne développe pas une science de l’action et de l’efficacité. Cela, c’est l’apanage de la science et de la technologie. Le symbolisme est une science de l’Etre qui nous parle de la nature des choses. Il nous apprend à voir bien plus qu’à agir et à transformer. Et il répond à la question philosophique : « qui suis-je ? ». Nous avons évoqué rapidement le fait que les drapeaux nationaux et les feux tricolores ne sont peut-être que pas de simples conventions, ni les fruits des aléas de l’histoire. La même analyse pourrait se répéter en choisissant de nombreux autres exemples. Prenons simplement les mots que nous utilisons dans la langue française. La « maladie » ne nous parle-t-elle pas du « dit du mal », et plus précisément encore le symptôme n’est-il pas le symbole d’une souffrance (le mal) de la Déité (D.I.T.) qui cherche à se dire ? En d’autres termes certaines pathologies sont, comme les mots nous le rappellent, un cri silencieux du mythe fondateur de l’être (« sa déité ») qui souffre, faute de trouver des voies d’expression objective. « Anorexie » se décode : « je sais que je porte en moi de l’or (or) mais je me sens privé (a) d’axe (exie) et incapable d’affronter ma violence (n, haine) ». Il existe ici un désir de perfection (l’or) qui ne peut s’exprimer du fait d’un refus (a) de la haine (n) et d’un manque d’incarnation (ex, en dehors de) autour de sa verticalité (I). Egalement : « je refuse de voir (a privatif) la haine qui m’habite (N) et me prive d’eau (O) et d’air (R) au risque de perdre mon axe (exie) ». Côté lumière, la maladie nous dit « Anneau Rex I », le désir d’alliance (anneau) avec le roi (Rex) divin (I). Cette maladie des hauteurs renvoie directement au mythe de Prométhée qui traite justement du paradoxe de l’alliance et de la liberté. Un dernier mot pour la route et pour le plaisir : l’interdit. « Inter-dit » se lit ce qui est « entre les dits » et, d’une manière plus métaphysique, ce qui est « entre la déité (DIT) ». L’inaccessible, pour nous les hommes, c’est bien sûr tout ce qui n’a pas encore été verbalisé, tout ce qui est resté dans le monde du silence sans jamais recevoir aucune définition, même très imprécise. Tout ce qui n’est pas formulé nous est interdit. N’oublions pas que formuler un interdit c’est déjà dire quelque chose et par conséquent sortir de l’inter-dit. Le véritable interdit, c’est l’inimaginé et le non verbalisé, là où les mots sont absents. Et pour celui qui a la foi il s’agit de tout ce qui n’est pas dieu. Mais c’est là seulement une question d’éclairage puisque la déité est « d i t », dieu est Parole. Par leurs sonorités et la forme de leurs lettres les mots cherchent à nous dire quelque chose. De ce point de vue la langue serait semblable à une entité vivante avec sa vie, son histoire et son sens intrinsèque porté par des mots-symboles. Si les couleurs, les formes des lettres et leurs sonorités font symbole il est temps à présent de tenter une définition de ce terme. Les symboles, le langage de l’êtreL’hypothèse d’une préexistence de forces signifiantes peuplant le monde imaginal et d’une interaction permanente entre celui-ci et le monde psycho-physique habituel à deux conséquences : le phénomène de synchronicité et le réel symbolique[4]. Les symboles sont les traces laissées par des archétypes entrés en contact avec notre monde. Un marcheur laisse l’empreinte de son pas sur le sol meuble. Un archétype marque la Terre de manière similaire. La taille, la profondeur et la forme de l’empreinte du soulier informe l’observateur sur la corpulence, le sexe et la direction du promeneur. Les formes, les couleurs et les sonorités du symbole révèlent partiellement la nature de la force signifiante qui est passée par là. Le symboliste observe ce qui transparaît derrière ce qui apparaît. Certes, il ne « voit » pas tout. Il ne verra jamais tout car l’empreinte n’est qu’une faible partie de sa cause. C’est pourquoi un symbole est à la fois polysémique et incomplet. Polysémique car il manifeste la richesse d’un archétype, incomplet car ce n’est là qu’une « signature ». Et la signature n’est pas la personne. Face à un symbole, il est essentiel de tirer sur le fil d’une lecture qui se profile sans s’arrêter benoîtement aux premières conclusions. De plus, comme dans le laboratoire scientifique, c’est toujours la nature qui a raison et non les théories ou les espérances humaines. C’est pourquoi une interprétation symbolique ne devrait jamais rester isolée afin d’éviter l’écueil la projection et l’imagination. L’interprétation se confirme lorsque plusieurs faisceaux de sens concourent vers la même direction. Prenons un exemple. La forme serpentine de l’intestin rappelle les circonvolutions du néocortex ; le serpent est symbole, entre autres, d’une transgression pour la connaissance ; la « panse » du bas résonne euphoniquement avec la « pense » du haut ; le latin « in-testus » signifie « dans la tête » ; des neurones agrémentent la paroi intestinale ; le labyrinthe gestaltique renvoie au mythe d’Icare et à sa folle tentative d’égaler l’Esprit par l’esprit ; la fonction de l’intestin consiste à séparer le bon grain biologique de l’ivraie, elle est analogique à celle du cerveau qui sépare la vérité de l’erreur ; lorsque l’enfant n’a pas envie d’aller à l’école il a mal au ventre : tous ces indices convergent vers une même idée force tendant à faire de l’intestin un « cerveau » sur son propre plan. Du reste, suprême ironie de la langue française, les « tripes » forment l’anagramme du mot « esprit ». Une autre clef de lecture consiste à conserver dans un coin de notre mémoire le fait qu’un symbole représente très souvent une chose et son contraire, fidèle en cela à la nature de l’archétype qui est à la fois ombre et lumière. C’est ce que Jung appela la « conjonction des opposés ». Ainsi la pomme, symbole infiniment riche et polysémique, contient plusieurs idées contraires. La conscience de veille (« ma pomme » = « moi ») et la perte de cette conscience (« tomber dans les pommes ») ; l’imaginaire chrétien à curieusement associé ce fruit à l’arbre du Paradis et au processus de la chute, malgré le fait que la Genèse ne précise nullement la nature de cet arbre-là. Or la chute est précisément le premier pas vers la conscience de soi : « et ils virent qu’ils étaient nus » précise le texte[5] après la sortie de l’Eden. La pomme est encore un symbole de concorde puisqu’elle fut offerte par Gaïa au couple Zeus-Héra pour honorer leur mariage… et de son contraire, la discorde que met en scène le jugement de Pâris qui entraînera le divorce de la belle Hélène et la guerre de Troie. Elle symbolise aussi l’immortalité (la Freïa germanique) et la mort (le fruit empoisonné des contes). Lorsqu’un symbole commence à révéler sa double nature, c’est là un indice sûr que le fil sur lequel tire le symboliste est bien enraciné dans un archétype ! L’aspect contradictoire du symbole est garante de l’évolution et de la transformation permanente du monde du sens. Sans cette conjonction des opposés rien de vraiment nouveau ne pourrait apparaître. Nous avons un vague reflet de cela lorsqu’une science, sous la pression des paradoxes qui la bousculent, change de regard sur le monde et ouvre des voies de recherche totalement nouvelles. Dans le monde du sens la contradiction, loin de signer l’erreur comme dans l’univers objectif, désigne la force de la vie en action. Une autre manière d’évoquer la polysémie du symbole consiste à introduire la notion de dégradation de l’archétype. En descendant en quelque sorte de l’invisible vers le visible la force signifiante perd de son ampleur et se colore des systèmes de croyances générés par les cultures spécifiques et par l’histoire de l’humanité. En d’autres termes un symbole n’est jamais « pur » car il appartient à un temps et à un espace donné. Ainsi, par exemple, dans toutes les traditions du globe l’acquisition de la connaissance s’accompagne toujours d’un rapt et d’une transgression. L’univers nous rappelle sans cesse et partout que des forces contraires s’opposent au connaître et que celui-ci n’est atteint que si l’homme trahit le monde des dieux. Cette grande idée est pourtant mise en scène de manière particulière par chaque tradition culturelle et religieuse. Le Prométhée Grec vol le feu du soleil de son propre chef, l’Adam biblique écoute les recommandations de sa compagne et du serpent. D’autres cultures évoquent encore bien d’autres péripéties, mais toujours autour de cette idée centrale du vol, de la transgression et de la punition. Il existe donc plusieurs « niveaux » de manifestation du symbole depuis sa dimension universelle jusqu’aux symboles personnels en passant par les grandes images culturelles. Les images des rêves son personnelles, les drapeaux nationaux sont culturels, le thème du vol du feu est universel. Pourtant tous se relient à un ou plusieurs archétypes fondateurs qui en sont, en quelque sorte, la source. Un langage s’appuie sur des mots, leur assemblage forme des phrases. C’est là une construction spécifiquement humaine. La nature muette à inventé une autre manière de dire qui elle est. Le langage de l’Etre parle par la voie des symboles, ses phrases sont des assemblages d’images symboliques. C’est là la définition la plus simple du mythe. Une histoire mythologique est en fait une constellation de sens, ce sont des symboles qui ont décidé de vivre leur vie ensemble et d’accompagner la nature dans une direction particulière. Analogiquement ils réalisent ce que savent faire les cellules sur la plan biologique : s’associer pour former des organes et des organismes. Il existe enfin des systèmes analogiques comme l’astrologie, les tarots, l’arbre des séphiroths et les sept rayons de la tradition théosophique qui franchissent un pas supplémentaire. Ces systèmes théorisent le monde symbolique et tentent de représenter la nature des forces vives du monde du sens. Ce sont des théories analogiques, les équivalents des théories logiques que nous connaissons dans le monde scientifique. En résumé l’Etre possède des mots pour se manifester (les symboles), des phrases pour dire ses valeurs (les mythes) et une grammaire pour se comprendre (les systèmes analogiques). Le symbole ne démontre rien, il se contente de montrerIl serait dangereux d’appliquer la logique de la cause et de l’effet au monde symbolique. Ce serait aborder cet univers avec des catégories qui lui sont étrangères au risque de furieux contresens. Les symboles, les mythes et les systèmes abstraits qui tentent de les ordonner sont là uniquement pour montrer. Ils ne démontrent absolument rien car ils ne relèvent pas d’une logique causale. Une fois encore ce n’est pas la force électromagnétique du feu rouge qui arrête les automobilistes, ni le choix de cette couleur pour dessiner le drapeau nazi qui fut à l’origine de la seconde guerre mondiale ! Ce sont là des évidence. Pourtant c’est devenu un lieu commun que de parler d’« influences » astrales, de l’effet des lettres hébraïques sur la conscience du méditant, ou encore de la « carte de rayons » qui structure et organise la nature d’une personne. Que fait-on alors ? Les vieux automatismes de la pensée sont durs à amollir : un effet sans cause semble impossible. Aussi, pour sauver la mise, l’intellect imagine des causes plus qu’improbables. Les influences astrales sont au moins aussi faibles que l’intensité de la lumière du feu tricolore, sans parler du fait que des lieux d’où n’émane aucune énergie (un drapeau, un point géométrique de l’espace comme le second foyer de la lune autour de la terre[6], une forme géométrique particulière, une photo) s’avèrent avoir des impacts considérables dans le monde psycho-physique. Alors la pensée qui a horreur du vide saute sur ses vieilles catégories et imagine une causalité pour émousser le vertige qui l’étreint. Comment dès lors comprendre cette situation impossible : un effet sans cause ? Dans un premier temps il est sage pour l’apprenti symboliste de remettre cette question à plus tard car ses conséquences sont immenses. Toute connaissance commence par une longue observation avant d’oser des théories. Or le symbole est le langage de la nature et de l’inconscient, par lui le monde objectif et l’univers de la vie intérieure nous parlent de leur nature profonde. Une nature saturée de sens, une nature emplie de vérité. Gœthe exprimait déjà cela d’une manière saisissante en notant que « le bleu du ciel est déjà la théorie du ciel ». Le premier pas vers le monde symbolique consiste à entrer dans le non-savoir. S’il est vrai que le sens existe en soi, alors le mieux sera de laisser de côté nos systèmes de croyances pour ouvrir notre conscience et notre cœur au silence des dieux, des plantes, des étoiles, des sonorités et des images. En bref expliciter et transmettre le sens d’un symbole est grand consommateur d’informations scientifiques, mythologiques, artistiques, historiques, littéraires, biographiques et ésotériques. Maiscomprendre un symbole suppose un oubli momentané de tout cela par l’acceptation d’entrer dans notre ignorance jointe à une ouverture sensible à la présence du sens qui cherche à se révéler à notre conscience. L’exploration du monde du paradoxe impose au chercheur de se mettre lui-même dans l’état paradoxal de la docte ignorance. L’opérativité du symboleC’est là une évidence pour qui s’est penché sans a priori sur la question. L’astrologie parle fidèlement de la personne, les tarots répondent de manière surprenante aux questions des consultants, tout comme la lecture dans le marc de café[7], dans les entrailles des animaux sacrifiés, ou encore dans le tirage des tiges d’achillée qui détermine les oracles du Yi King. Si les systèmes symboliques sont efficient, les symboles le sont aussi : contacter intérieurement une plante à coté de soi peut induire un processus de guérison. Ce sont là les travaux du Dr. Bach à l’origine des Elixirs Floraux. Un témoignage digne de confiance, et vérifié par l’Eglise Catholique, nous a rapporté avoir vu une photo de la Vierge accrochée à un mur pleurer. J’ai aussi rencontré en Inde un yogi qui, comme Saï Baba, matérialise des cendres (le vibuti) afin de nettoyer le karma de la personne à qui il s’adresse[8]. Un autre maître spirituel à ce pouvoir, entre autres choses, de transmettre la grâce divine à travers ses photographies[9]. Sans même aller jusque là il est possible de montrer que les mythes grecs qui fondent en partie notre culture occidentale sont encore vivants aujourd’hui[10]. Accepter l’opérativité du symbole est difficile pour la mentalité moderne car cela questionne les fondements même d’une culture construite sur la rationalité du monde. Alors la tentation est grande de nier tout cela en bloc, ou encore de le réduire à une improbable causalité. Pourtant, pour celui qui a commencé à voir le symbole, le chemin de son opérativité se déroule devant lui dans une aveuglante et déstabilisante évidence. Comment dès lors penser le monde symbolique ? Est-ce seulement possible puisqu’il semble se situer en dehors de nos processus mentaux habituels ? Les lois de l’univers symboliqueNous n’avons là-dessus, à ce jour, qu’une réflexion fragmentaire. Nous avons déjà évoqué quelques « principes » de base :
Ajoutons encore que sa fonction première, donnée par l’étymologie de symbolein(« réunir ») consiste à rassembler des mondes qui, d’habitude s’ignorent. Notamment la réalité objective avec le royaume subjectif et le monde spirituel. Les mythes et les symboles organisent notre réalité au moins autant que les lois mises en évidences par la science. Par contre ils sont « platoniciens » dans la mesure où leur action est indépendante du niveau d’organisation auquel ils s’adressent et du support matériel qu’ils utilisent pour transparaître. Ainsi le mythe de Prométhée marque à la fois les plans spirituel (l’ardent désir d’Eveil), historique (le siècle des Lumières), musicaux (la 9e Symphonie), biographiques (Beethoven), pathologique (l’anorexie, la migraine), social (la Révolution Française), philosophique (la liberté) et économique (le libéralisme). Evidemment toutes ces manifestations du sens sont très différentes les unes des autres, mais elles sont toutes animées par une même « intention », une même « âme » : celle qui aspire violemment à une nouvelle alliance avec un monde rénové. C’est pourquoi le symbole à le pouvoir de réunir : en rassemblant par le sens des modes d’expression jugés très disparates au premier abord. Il s’oppose bien sûr au « diabole » qui règne sur une autre opération fondamentale : la division. La démarche scientifique se fonde justement sur la division et la comparaison. Deux attitudes que récuse la démarche symbolique. Non que la science soit « diabolique », mais elle est réellement pertinente là où règne la mort : dans le monde des objets. Rappelons qu’il n’existe pas aujourd’hui de théorie du vivant, mais seulement un amoncellement d’observations qui ne nous disent rien sur la vie. Le symbolisme est le langage naturel de la psychologie car il porte le sens. Pourtant, si la science a besoin de la pensée analytique et séparatrice pour se renouveler, le symboliste qui ne considérerait que cet outil aurait de la difficulté à percevoir les essences qui affleurent derrière la multiplicité des formes. Ici, c’est le cœur qui est le canal de la connaissance. Plus large le cœur est ouvert, plus sensible il est, plus le monde symbolique devient une évidence. Le mental prendra seulement ensuite le relais pour expliciter les informations perçues. La démarche symbolique impose de renoncer au sacro-saint principe d’objectivité expérimentale et demande d’oser relier notre intérieur avec notre extérieur… jusqu’à ce que cette différence s’efface dans la conscience de l’unité du premier avec le second et que grandisse le sentiment d’unité : c’est cela le réenchantement du monde. Repenser l’homme et sa fonction dans le mondeMalraux remarquait un jour que chaque grande époque de la civilisation occidentale était tendue vers le développement d’un type d’homme idéal fondé sur sa représentation du monde, à l’exception de la nôtre. Le Grec défendait l’idéal d’un homme libre capable de discuter d’égal à égal avec les dieux ; le Romain celui du sénateur qui respecte le droit et affirme le pouvoir de l’Etat ; le Moyen-Âge à vu l’émergence du personnage du Chevalier au service de sa dame et en quête du « graal ». Le dernier en date, l’Empire Britannique, à produit la figure enviée du Lord. Quelle image emblématique de l’homme propose la société industrielle ? Quel idéal humain avons nous à offrir à nos enfants ? Il y a bien sûr les images du chercheur, de l’ingénieur, du technicien et du commercial. Mais ces gens-là sont les conséquences de notre manière de penser rationnellement le monde plutôt que des idéaux capables d’élever la nature humaine vers la fine pointe d’elle-même. Notre époque rationnelle assèche en quelque sorte les incroyables richesses potentielles de l’être humain en le réifiant, conséquence inattendue d’une objectivité mécanique érigée en règle de pensée. Or le monde symbolique nous oblige à repenser la nature humaine et son rôle au sein de son environnement visible et invisible. Imaginons un instant ce que serait un monde où le symbole à droit de cité. Un monde qui aurait intégré dans son quotidien un hypothétique « Discours de la Mythode » dont le symbole serait la pierre angulaire. Celui-ci « porte » en quelque sorte le sens, exactement comme les mathématiques « portent » notre compréhension du monde objectif. L’analogie s’arrête là. En effet, lors de l’exploration l’espace intérieur du chercheur se substitue au laboratoire de recherche ; le sens esthétique remplace le sens pratique, la subtilité se substitue à la force ; le non-effort et l’acceptation de l’inconnu priment sur l’effort et l’accomplissement d’objectifs assignés ; le lâcher prise marque la victoire alors que la conquête est l’indice de l’échec ; la coopération devient de plus en plus une évidence naturelle alors que les restes de l’esprit de compétitivité marquent l’inaccomplissement du sentiment d’unité du réel. La chose n’est pas aisée dans notre modernité, ce monde qui déplace des montagnes non pour aller vers les jardins d’un quelconque Prophète, mais pour creuser des autoroutes vers le soleil d’un midi profane. Ce monde-là multiplie les occasions de bruit et de bavardages, il effraie des milliers colombes qui s’envolent à tire d’ailes, contrariant ainsi l’ardente intuition de Nietzsche qui affirmait que « ce sont des paroles silencieuses qui apportent la tempête ; des pensées qui viennent sur des pattes de colombes dirigent le monde[11] ». Ce monde moderne confond la douceur avec la faiblesse, par sa barbarie même il réfute, non le symbole – puisque celui-ci est inhérent au réel – mais toute opportunité de voir l’enchantement de la Terre qui sourit au regard symbolique. Or la Terre est aussi un enchantement. Ce n’est pas seulement une carrière à ciel ouvert où tous les ambitieux et tous les assoiffés de reconnaissance jouent aveuglément comme dans une cruelle cour de récréation. Les arbres, les arbustes et les herbes « disent » au moyen de leurs formes, de leurs couleurs et de leurs textures, les liens sympathiques qu’ils maintiennent avec les étoiles, mais aussi avec les organes du corps humain. Par ce qu’ils sont, ils décrivent très précisément leur sens : ce qu’ils soignent, et l’équilibre perturbé que leur simple présence réajuste. Poursuivant sur cette voie l’écologie se fait sensible. C’est une écologie à mille lieues de la compréhension intellectuelle du fonctionnement des écosystèmes. L’écologie sensible perçoit la beauté de la nature, dialogue avec les plantes et les rivières, un peu à la mode amérindienne, où encore dans l’esprit des travaux d’Edward Bach sur les élixirs floraux. Alors le jardin terrestre n’est plus seulement un monde assujetti aux caprices de homme mais un univers vibrant et vivant où l’être humain trouve sa place en devenant une fleur parmi d’autres fleurs. Pour la première fois, par la médiation du symbole, l’homme perçoit directement la nature de la Nature au lieu de projeter sur elle ses rêves, ses angoisses et ses théories. Une société attentive à la présence vivante et vibrante du réel, à l’âme du monde, développerait une écologie naturelle où l’humanité ne serait plus considérée comme un enfant capricieux que doit allaiter la Terre-Mère - ou encore comme un apprenti maître du monde enivré par ses nouveaux pouvoirs - mais comme une consciencesensible co-participative à l’évolution des autres règnes de la nature selon leurs propres lois. Dès lors, avec cette conscience-là, comment serait-il possible de mettre en danger le biotope ? Là où la loi et la force échouent, le simple changement de regard fait merveille. De même, lorsque le corps parle de ses souffrances, lorsque la maladie dit le mal auto-infligé par celui qui ferme ses oreilles aux hurlements tragiques du Destin qui l’a pelle, le bistouri supprime le symptôme… et entérine d’un coup vif la surdité ontologique du patient. Inversement, celui qui voit et entend que son corps symbolise un mal-être au moyen de la maladie évite la fuite dans l’absorption des pilules « miracles » des officines. Il verbalise le dit du mal, le « mal a dit », chacun le sait. Ainsi, lorsque le symptôme se fait parole, lorsqu’il devient conscience de quelque chose, celui-ci disparaît car il n’a littéralement plus « lieu d’être ». Une lecture symbolique du corps humain et de ses pathologies révolutionnerait les concepts médicaux aujourd’hui en usage… ainsi que le gouffre de la sécurité sociale ! Et puis il y a la vie quotidienne. Un jour, un journaliste demanda en substance à Einstein : « à votre avis, quelle est aujourd’hui la question la plus importante à résoudre ? » De la part d’un éminent scientifique la réponse attendue concernait un problème de physique important pour l’époque. Mais pas du tout. Einstein répondit : « aujourd’hui, la question essentielle est de savoir si l’univers est accueillant ». Etonnant, non ? Et pourtant ! Ô combien est-il essentiel de vérifier si l’univers est bon. Car s’il est « accueillant » plus rien ne justifierait la compétitivité, la concurrence, l’effort, la guerre, la société de contrôle et la hiérarchie autoritaire qui fondent notre réalité commune. S’il ne l’est pas, par contre, il est légitime de fonctionner sur la peur et de se barricader derrière des lois, des serrures de sécurité et une attitude de méfiance les uns envers les autres. Or que nous apprend le regard symbolique au quotidien ? Que les événements de notre vie sont les reflets exacts de nos plus intimes pensées. Tout ce qui nous « arrive » n’appartient ni au hasard ni à la fatalité, mais est là pour éveiller notre conscience sur notre nature profonde. Les événements de notre vie sont autant de messages qui nous rappellent sans cesse qui nous sommes. Alors nous comprenons que l’univers n’est ni bon ni mauvais, il est simplement juste. C’est un fidèle reflet, à travers les événements qu’il nous propose de vivre, de nos peurs, de nos angoisses, de nos joies et de nos espoirs enfouis. La Terre enchantée par le symbole n’est pas un paradis new-age où tout le monde s’aime et se respecte dans l’utopie infantile d’un paradis de facilité, de facticité à vrai dire. Regarder droit dans les yeux les messages symboliques demande du courage. Le courage et l’humilité de sa fragilité ; le courage nécessaire pour l’ouverture de sa conscience vers des zones encore inconnues de soi-même et, finalement, le courage de l’amour de celui qui sait se laisser toucher par la nature du réel sans jamais le répudier ni chercher à le transformer. [1] Le scientisme est la science comme idéologie, c’est-à-dire la croyance non démontrée que tous les phénomènes sont produits par des interactions matérielles mesurables et quantifiables. Le XIXè siècle avec Auguste Comte fut l’apogée de cette croyance élevée au statut envié de vérité. Bien que les données de la mécanique quantique et l’extraordinaire intelligence du vivant questionnent aujourd’hui cet a prioribeaucoup de penseurs contemporains adhèrent encore spontanément à cette vision du monde. [2] Il serait trop long de l’argumenter ici. C’est fut l’objet de deux ouvrages que nous avons publié ailleurs L’Homme Réunifié (éd. de Janus) traite de la complémentarité entre les deux hémisphères du cerveau. Sur cette base nous avons cherché à développer une méthode pour explorer le monde du sens et répondre ainsi au « savoir faire » de l’hémisphère droit. La Force du Symbolique (Dervy) poursuit cette réflexion en explorant les caractéristiques et les limites des quatre grandes approches de la connaissance : la raison scientifique, l’approche systémique, l’analyse symbolique et l’exploration directe par le contact intérieur avec le monde du sens. [3] Georges Dumézil, dieux et mythes des Indo-Européens () ainsi que la courtisane colorée ? La société chinoise n’est pas Indo-européenne, mais on peut montrer que le yin et le yang auquel s’est beaucoup intéressé Leibniz pour fonder le langage binaire occidental « universel » est en fait un cas particulier de cette logique ternaire. Sur Leibniz voir le numéro 28 des « génies de la science » qui lui est consacré. [4] Il ne faut pas confondre le réel symbolique et la symbolisation du réel auquel procède l’enfant lors de son apprentissage. Le « réel symbolique » considère que la nature, le langage et l’inconscient sont en soi des symboles qui expriment à leur manière la nature de la nature, le sens profond des mots et la personnalité du rêveur. Symboliser la réalité est une opération mentale qui a pour objectif de se représenter le monde extérieur. Elle est à la source de la culture. [5] Une autre raison est peut-être en relation avec le latin pomus qui signifie « fruit » et à donné en français le mot « pomme ». Mais c’est une explication qui reste centrée sur une langue vernaculaire. [6] Ce point est la « lune noire » dans le système astrologique. [7] J’étais il y a quelques années en voyage en Turquie, nous étions quatre. Un chauffeur de taxi avec qui nous avions sympathisé nous a proposé de rencontrer un homme qui avait ce don de lire dans le marc de café. Chacun d’entre nous fut vivement impressionné par sa lecture à tel point que, voyant notre réaction, il décida d’abréger afin de ne pas trop nous vexer ! [8] Swami Sri Lakshhmanacharya est un yogi qui habite dans l’Inde du sud, à Renigunta près de Tirupati. Il appartient à une longue lignée de yogi conseillés des princes de Mysore. Dans la grande tradition hindouiste il reçut sept années formation incluant divers exercices de méditation, de mantras et de musique, complétées part douze ans de solitude dans l’Himalaya sous la direction de son maître spirituel. Dr. en médecine ayurvédique il possède une double formation scientifique et yogique. [9] Bhagavan, voir le site Internet où est présenté son « travail » : http://www.onenessuniversity.org. Son ashram, la Golden Age Foundation, se situe à 80 Km au nord ouest de Madras. [10] Voir par exemple l’ouvrage que nous avons consacré au mythe de Prométhée. Son analyse symbolique relève bien des composants de notre modernité, en montre les limites et suggère une manière de ne pas se laisser broyer par l’idéologie du Progrès. Nous avons également montré que l’œuvre et la vie de Beethoven pouvait se comprendre à la lumière de l’aventure du Titan. (Luc Bigé ; Prométhée, le mythe de l’homme, publié aux éditions de Janus). Sur le rôle du mythe dans l’histoire voir également les ouvrages de Gilbert Durand, notamment son « introduction à la mythodologie » publié au livre de poche. |
Submit your review | |
Voir les commentaires : 0
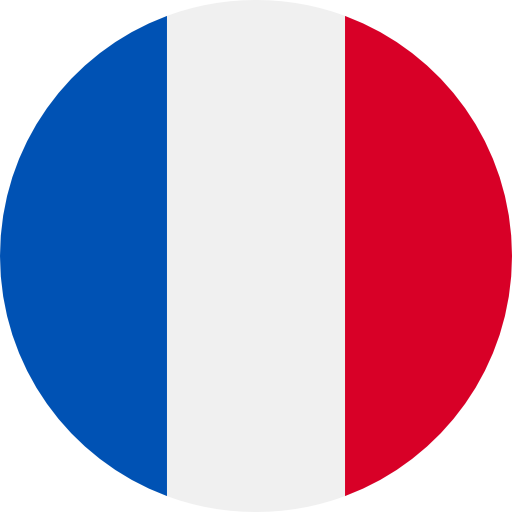 français
français
 english
english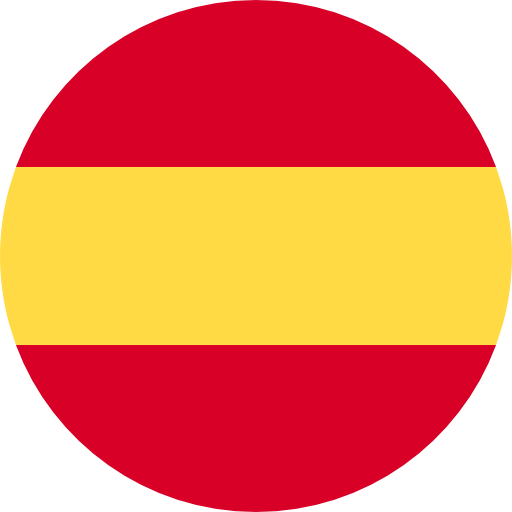 español
español русский
русский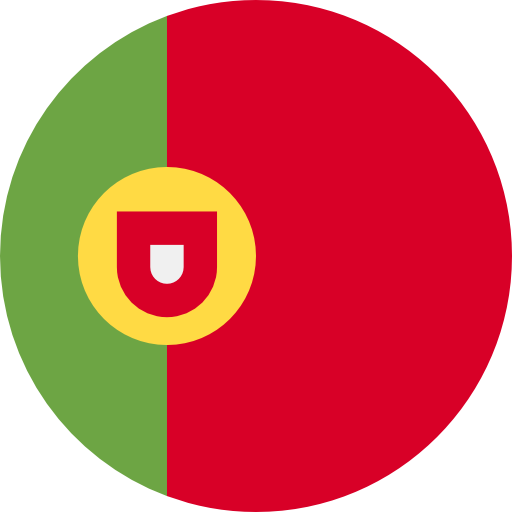 português
português